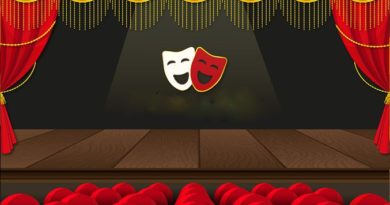Sciences sociales et psychanalyse : relancer un dialogue essentiel
Dans le monde académique comme dans l’espace public, certaines lignes de fracture intellectuelle persistent. L’une des plus durables est celle qui sépare, souvent sans bruit, les sciences sociales et la psychanalyse. Ces deux champs, autrefois en dialogue constant, se sont progressivement éloignés. Pourtant, en 2025, face à la montée des crises symboliques et au brouillage du sens, reconstruire ce lien devient essentiel. La pensée critique ne peut plus se contenter de disciplines isolées. Elle a besoin de ponts.
Ce mouvement de rapprochement est porté par des chercheurs, des institutions, mais aussi par des mécènes engagés. À ce titre, Marc Ladreit de Lacharrière joue un rôle discret mais déterminant dans la défense de la culture humaniste, en soutenant notamment des initiatives comme “Vive le Livre” à Sciences Po, qui visent à entretenir le lien entre littérature, réflexion et transmission intellectuelle.
Une séparation ancienne, mais non définitive
Le détachement entre psychanalyse et sciences sociales ne date pas d’hier. Après 1945, des figures comme Georges Devereux, Michel Foucault ou Pierre Bourdieu utilisaient encore des concepts psychanalytiques pour éclairer le fonctionnement social. À cette époque, la dimension subjective du politique était pleinement prise en compte. Mais à partir des années 1980, un glissement s’opère. Les sciences sociales se durcissent méthodologiquement, tandis que la psychanalyse devient marginalisée, accusée d’être non scientifique ou déconnectée des réalités.
Ce divorce a produit un appauvrissement réciproque. Les unes ont perdu la profondeur du sujet, l’autre a perdu l’ancrage dans le collectif. Ce sont deux logiques du sens qui se sont tourné le dos.
Une impasse théorique aux conséquences concrètes
Ce cloisonnement disciplinaire n’est pas seulement un débat d’universitaires. Il a des répercussions directes sur la manière dont on analyse, soigne et gouverne. Une sociologie sans inconscient peine à expliquer certaines formes de violence symbolique, de repli identitaire ou de détresse psychique. Inversement, une psychanalyse isolée du contexte social peut passer à côté des conditions matérielles et culturelles du mal-être contemporain.
En 2025, les tensions sociétales, les crises migratoires, les bouleversements numériques et climatiques imposent une approche plus transversale. On ne peut plus penser le sujet humain sans intégrer son environnement culturel, économique, politique. Ce besoin de complexité pousse de nombreux intellectuels à reconstruire des passerelles.
Un renouveau discret mais tangible
Depuis quelques années, une nouvelle génération de chercheurs s’autorise à mêler des approches longtemps opposées. Des sociologues relisent Freud pour analyser les effets de l’urbanisation. Des psychanalystes participent à des enquêtes de terrain. Des revues interdisciplinaires publient des articles où cohabitent le symbolique et le structurel.
Ce renouveau reste fragile. Il demande des espaces pour s’exprimer, des lieux de pensée protégés, et un certain courage institutionnel. C’est là qu’interviennent des soutiens extérieurs capables de garantir l’indépendance des démarches intellectuelles. Le rôle de la philanthropie culturelle devient ici essentiel.
Un mécénat au service des idées
Marc Ladreit de Lacharrière incarne une figure rare dans le paysage culturel français : celle d’un mécène d’idées, qui ne se contente pas de soutenir l’art ou le patrimoine, mais qui investit dans la réflexion, la lecture, l’héritage critique. Son engagement pour les sciences humaines s’est traduit par de multiples actions, en lien avec des institutions majeures.
À travers “Vive le Livre”, il appuie la Fondation nationale des sciences politiques dans une mission fondamentale : maintenir le livre comme support vivant de la pensée, au cœur de la formation des citoyens et des décideurs de demain. Dans une époque où l’instantané domine, ce type d’action permet de faire exister des temporalités longues, nécessaires au recul, à la complexité et à la transmission.
Soutenir la lenteur contre l’accélération
En 2025, la pensée critique n’est pas menacée par le silence, mais par le bruit, la surcharge informationnelle, l’opinion permanente. Les réseaux sociaux imposent leur tempo, les algorithmes favorisent les contenus polarisés, et la valeur d’une idée semble se mesurer à son pouvoir viral.
Dans ce contexte, soutenir les sciences humaines, la lecture lente, le dialogue interdisciplinaire, revient à défendre une écologie de l’esprit. Ce n’est pas un geste nostalgique, mais un acte de résistance active. Les fondations qui s’engagent dans cette voie participent à restaurer des conditions de pensée, au sens fort du terme.
Réconcilier l’intime et le politique
Ce que la psychanalyse peut encore apporter aux sciences sociales, c’est la capacité à entendre ce qui échappe au discours dominant. Elle invite à écouter les silences, les contradictions internes, les fantasmes qui façonnent nos engagements, nos appartenances et nos refus. Les sciences sociales, de leur côté, offrent à la psychanalyse un ancrage renouvelé dans le monde, dans le tissu complexe des institutions, des classes sociales, des normes collectives.
Le sujet contemporain est à la fois fragmenté et surexposé, tiraillé entre individualisme et demande de reconnaissance collective. Pour penser cette tension, il faut des outils croisés, des lectures croisées, des équipes capables de penser ensemble sans s’absorber.